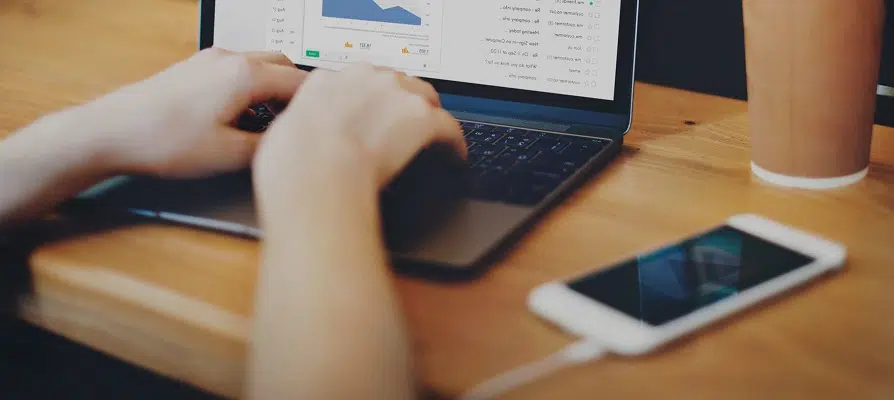30 % des attaques informatiques mondiales se concentrent sur moins de dix pays. En 2023, une étude des Nations Unies a mis à mal une idée reçue : les États les mieux notés pour leur cybersécurité ne sont pas forcément ceux qui subissent le moins d’attaques majeures.
Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis trônent en bonne place dans les évaluations internationales de cybersécurité. Pourtant, loin d’être à l’abri, ils constituent une cible idéale pour les cybercriminels, qui perfectionnent sans cesse leurs techniques. Plus un pays développe son réseau et ses usages numériques, plus il attire de convoitises malveillantes. Cette équation inverse le sens commun et relance la compétition mondiale autour de la défense numérique.
Comprendre la cybercriminalité mondiale : état des lieux et enjeux
La cybercriminalité, elle, ne connaît ni trêve ni frontières. Depuis vingt ans, l’European Repository of Cyber Incidents (EuRepoC) a recensé déjà plus de 2 600 cyberattaques d’envergure, menées pour des raisons politiques. Entre 2000 et aujourd’hui, la provenance des assauts est en partie identifiée : la Chine représente à elle seule 11,9 % des attaques documentées, suivie de la Russie (11,6 %), de l’Iran (5,3 %) et de la Corée du Nord (4,7 %). Les chiffres sont limpides. La digitalisation galopante n’a pas seulement boosté l’économie ou la communication : elle a ouvert la voie à des agressions toujours plus raffinées, aussi bien contre le public que le privé.
Pour mieux cerner qui sont les cibles favorites, voici les deux secteurs les plus exposés :
- Les institutions publiques, des mairies aux opérateurs hospitaliers,, soumises à des intrusions fréquentes et à des paralysies coûteuses.
- Les entreprises privées, souvent assises sur des bases de données vulnérables, convoitées par des hackers toujours plus ingénieux.
Face à ces deux mondes sous tension, les attaquants déploient une palette complète : phishing, ransomware, malwares. Ils rendent la tâche des enquêteurs ardue en multipliant les proxys et les relais informatiques à travers le globe. Derrière les opérations, on retrouve parfois des États, parfois des groupes opportunistes, ou encore toute une galaxie de sous-traitants numériques armés d’outils de contournement sophistiqués.
Panorama et méthodes de cyberattaques
La cybersécurité s’est hissée au rang de préoccupation géopolitique centrale. Des groupes comme Flax Typhoon, pilotés depuis Pékin, s’attaquent à des géants de la tech. Moscou vise l’Ukraine et ne se prive pas non plus de cibler des villes et collectivités françaises. L’Iran et la Corée du Nord ont choisi une voie similaire : Pyongyang compterait plus de 6 000 cyber-agents en opération.
Le piratage informatique se réinvente jour après jour, stimulé par les tensions géopolitiques et l’émergence constante de nouvelles technologies. Les impacts sont tangibles : systèmes entiers mis à l’arrêt, données siphonnées à grande échelle, entreprises et administrations extorquées par des rançons. Tandis que défenseurs et institutions renforcent leurs moyens, les attaquants innovent sans relâche.
Quels sont les pays les plus exposés aux attaques informatiques ?
Les statistiques révèlent une hiérarchie assez nette. Les États-Unis enregistrent 156 cyberattaques majeures entre 2006 et 2020, aucun autre État n’approche un tel volume. La France se positionne au quatrième rang, avec une explosion du nombre de fuites de données récentes. Sur le seul premier semestre 2025, 1,8 million de comptes français ont été compromis, soit trois internautes sur cent directement concernés.
Le secteur privé n’encaisse pas moins de chocs que le public. Été 2025, Bouygues Telecom a été victime d’un vol des données de six millions de clients. Les administrations ne sont pas épargnées : France Travail, ainsi que les plateformes de gestion Viamedis et Almerys, ont essuyé de multiples offensives depuis janvier.
Pour donner une idée de l’ampleur du phénomène, rappelons que la France totalise 521 millions d’adresses mail compromises depuis 2004 (source Surfshark). Sur ce plan, seuls les États-Unis, la Russie et la Chine enregistrent plus d’incidents. Première moitié de 2025 : la France devient même le pays le plus visé de toute l’Europe devant le Royaume-Uni et l’Allemagne.
À l’échelle globale, Chine (11,9 %), Russie (11,6 %), Iran et Corée du Nord tiennent les commandes de la cyberactivité agressive, leurs équipes frappant avec des objectifs aussi bien politiques que financiers. La combinaison de compétences affûtées chez les pirates et la multiplication des failles dans les systèmes d’information font de ces pays à la fois des lanceurs d’attaques et des cibles suivies de très près.
Critères d’évaluation : comment mesure-t-on la cybersécurité à l’échelle internationale ?
Évaluer la robustesse des systèmes informatiques au niveau mondial appelle à croiser plusieurs indicateurs. On observe d’abord la quantité et la régularité des cyberattaques repérées sur chaque territoire. Selon le dernier panorama des experts, 22 % de toutes les attaques identifiées visent les États-Unis, 13 % la Chine, 6 % le Japon et 5 % la France. Ce classement distingue les États les plus fréquemment ciblés et ceux qui orchestrent le plus d’opérations à l’étranger.
Mais d’autres données affinent le diagnostic. Les volumes de fuites de données ou d’adresses mail compromis éclairent le niveau réel de cybersécurité nationale. Des plateformes spécialisées (comme Surfshark, Cybernews, Statista) publient régulièrement des bilans basés sur la déclaration des incidents, qu’ils proviennent de l’État ou d’acteurs privés. Ces comparaisons tiennent aussi compte de la densité des réseaux, du degré de préparation des organisations et de la rapidité de réaction en cas de crise.
L’attribution précise des attaques s’avère souvent complexe puisque les cybercriminels s’appuient sur l’architecture mondiale d’Internet pour brouiller les pistes. Par exemple, la France héberge un nombre élevé de serveurs utilisés comme relais, ce qui peut générer des biais dans les statistiques. Enfin, la composition des secteurs durement frappés, santé, énergie, administration, services aux entreprises, pèse lourd dans l’analyse : chaque environnement présente ses propres faiblesses et des méthodes de protection distinctes.
Initiatives majeures et stratégies gagnantes des leaders en cybersécurité
Face à l’ampleur du piratage et à l’industrialisation des menaces, certains pays se dotent de véritables armures numériques. Les États-Unis, très exposés, misent sur la puissance : agences fédérales spécialisées, mobilisation des acteurs privés et programmes de formation renforcent une riposte collective, sans cesse renouvelée.
Côté français, la riposte s’organise autour de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Contrôles, audits, simulations, accompagnement des entreprises : l’agence multiplie les initiatives pour contrer phishing et ransomware. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, de nouvelles mesures ont été mobilisées, dans la lignée de Tokyo 2021 où les organisateurs avaient recensé 450 millions d’incidents. L’Anssi le martèle : la sophistication des attaques augmente, et l’origine des intrusions reste parfois insaisissable.
En Asie, Chine et Russie déploient des stratégies coordonnées : collaboration étroite entre cyberarmées et agences d’État, innovations technologiques pour garder une longueur d’avance sur les adversaires. Leur force repose sur la souplesse et la capacité d’adaptation de leurs équipes face aux techniques ennemies.
Si l’on cherche un point commun entre les pays en tête, il se dessine assez vite : formation continue des experts, veille permanente des menaces émergentes, coopération entre nations. Ces leviers humains et technologiques donnent aux défenseurs des atouts précieux pour limiter les dégâts et préserver la souveraineté numérique.
Rien n’est jamais acquis : dans cette nouvelle guerre de l’ombre, chaque relâchement se paie cash. La prochaine vague d’attaques n’attend pas, et ceux qui baissent leur garde découvriront bien vite ce que coûte l’oubli numérique.